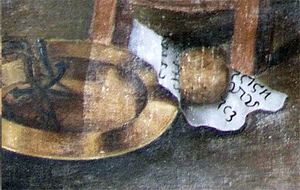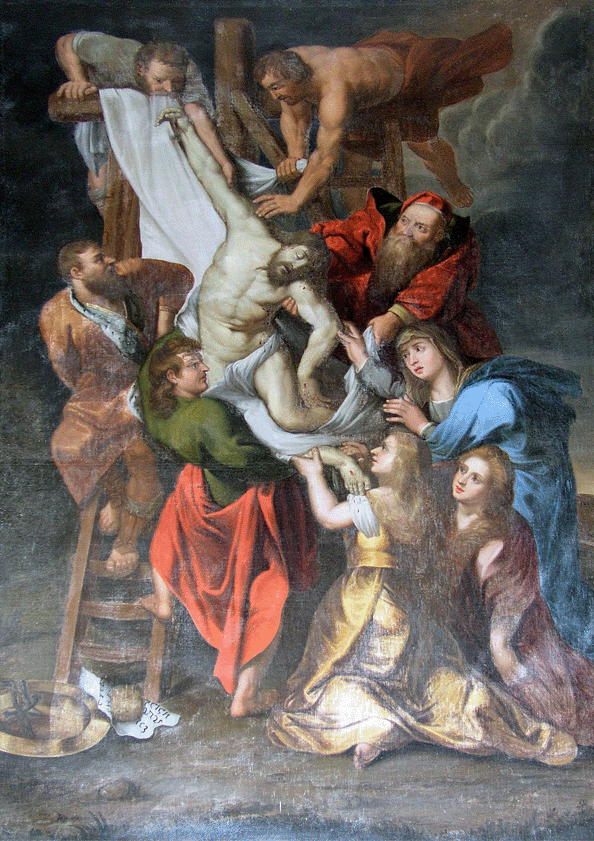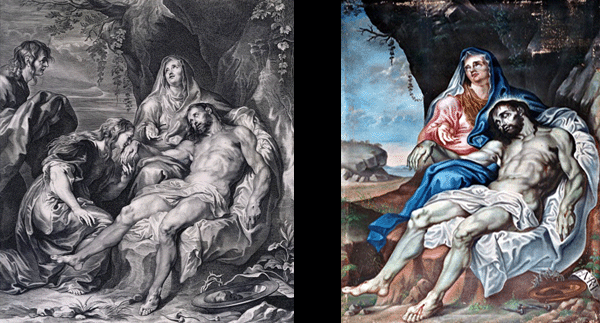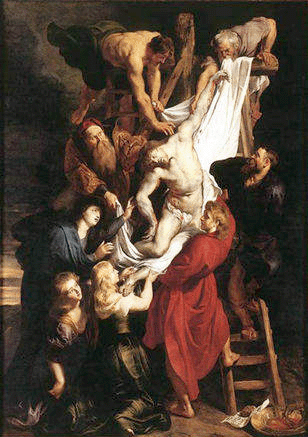|
|
|
|
Le
Rubens inversé
|
|
|
|
|
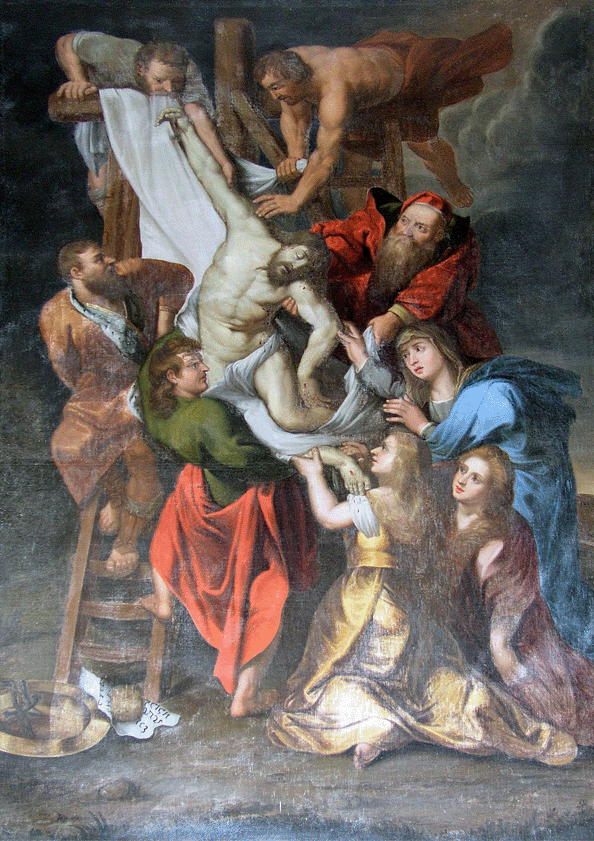
|
|
|
"Descente
de Croix" dans Notre-Dame du Cros (Aude)
(Photo François Pous)
|
|
|
|
|
Nous
avons vu combien était étonnants déjà deux tableaux présentés aux
visiteurs de Notre-Dame du cros, le premier
semblait avoir été repris par un médaillon de Notre-Dame de Marceille,
le second mettait en lumière une vieille allégorie utilisée par les
fils d' Hermès, voyageurs intemporels sur les voies de l'alchimie, la
lutte contre le dragon. Un troisième représente une
saisissante "Descente de la croix".
Un détail retient l'attention pour être mis en valeur sur un autre
tableau de Rennes-les-Bains : le célèbre plat doré qui servit à laver
les blessures infligées au Christ. Forme véritable et primitive
attribuée par les linguistes au mot Graal : plat creux (et non calice)
contenant ici, et sur les deux tableaux, la Sainte éponge.
|
|
|
|
|

|
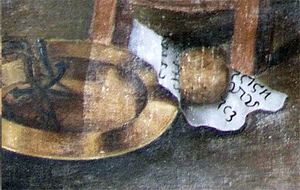 |
|
|
Le plat de la piéta de Rennes-les-Bains
|
Celui de la
Descente de Croix de ND du Cros
|
|
|
|
|
|
Nous
savons que le tableau de Rennes-les-Bains est une lamentation inspirée
de celle de Paulus Pontius, elle même copiée en inversion d'un tableau
du peintre Van Dyck sur laquelle très étrangement le INRI est inversé
et le plat doré très présent. Nous avons souvent rencontré cette
inversion (voir ici).
Le tableau de Van Dyck se trouvait autrefois dans l'église du
Béguinage d'Anvers. |
|
|
|
|
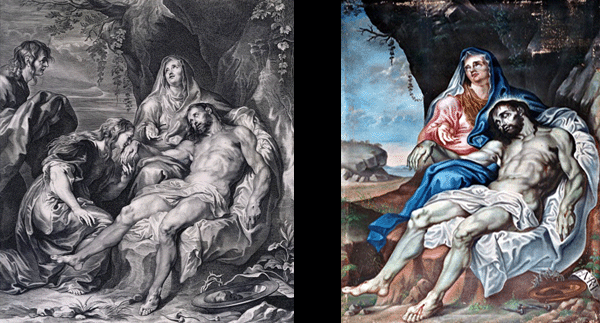
|
|
|
|
|
C'est aussi à un peintre pour
qui Anvers à beaucoup compté : Pierre Paul Rubens (1577-1640) que
nous devons le tableau original qui inspira le peintre de Notre Dame du
Cros. Panneau central d'un triptyque, le tableau de Rubens fut qualifié
par Théophile Gautier de plus beau tableau du monde et il faut le lire
décrivant le saisissement qu'il eut en le voyant exposé dans la
cathédrale d'Anvers :
|
|
|
|
|
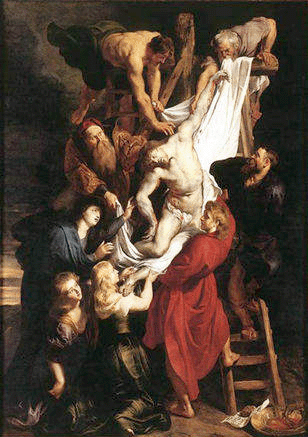
|
"L’albâtre
azuré et la blancheur morte du corps du Christ me saisirent tout d’abord
le regard. J’admirai comme le peintre avait su répandre sur les
membres de l’Homme-Dieu la pâleur opaque de l’hostie et faire ainsi
comprendre que tout son sang avait été versé jusqu’à la dernière
goutte pour le salut du monde.
Puis mes yeux se fixèrent sur la Madeleine, dont la blonde épaule
supportait son pied bleuâtre, et ne s’en détachèrent plus ../..
Aucun peintre, à mon avis, n’a mieux caractérisé la grande amante
du Christ, et Rubens en la dessinant s’est surpassé lui-même.
Elle est agenouillée dans une robe de soie vert émeraude, couleur d’espérance,
dont les flots bouffants s’épanchent autour d’elle en larges
cascades.
Ses longs
cheveux doucement crêpelés, où le soleil couchant semble avoir
laissé quelques-unes de ses teintes, descendent sur sa nuque potelée,
et finissent en s’effilant comme une frange d’or.
Un de ses bras
s’avance pieusement pour soutenir le divin cadavre. — Quel bras!
quelle épaule ! et quelle main ! Ni l’onde, ni la flamme n’eurent
jamais cette souplesse et ce moelleux.
Sur un fond de blancheur chaude et mate, aux endroits plus
amoureusement caressés par le jour, scintillent ces beaux reflets
lustrés, ces éclairs de satin et ce frissonnement lumineux dont Rubens
seul a le secret ; des demi-teintes plus dorées et plus fluides que l’ambre
noient harmonieusement les contours ; on dirait de l’ivoire élastique
et du marbre flexible.
|
|
|
|
|
Je
ne croyais pas tant de transparence compatibles avec tant de solidité.
Une humide lueur tremble sur le globe de son grand œil emperlé de larmes
limpides et levé avec une tristesse passionnée vers le corps du Sauveur,
qui tombe comme un fruit mûr de l’arbre de la croix.
Sa bouche à demi-entr’ouverte semble aspirer ardemment l’air qui
entoure le mort bien-aimé, et toute son attitude exprime un désespoir et
un amour si parfaits qu’il est impossible de n’en être pas touché.
Ce qui me charme surtout dans cette magnifique créature, c’est qu’à
la suprême beauté elle joint un sentiment de vie extraordinaire ; l’existence
court en fibres rouges dans cette peau de velours ; cette épiderme si
fine et si jolie cache des muscles invaincus.
Ce n’est pas
un ange, ce n’est pas une sylphide, c’est une femme, quelque chose qui
vaut beaucoup mieux, selon moi. Je n’ai jamais été un grand partisan
des beautés mourantes; je ne conçois guère la grâce sans la force, et
la Madeleine de la descente de croix réunit toutes les conditions de mon
idéal.
Ah ! Madeleine, Madeleine, que n’ai-je été ton contemporain !
A lire Théophile
Gautier, on sent bien qu' avant Dan Brown et nos anglais (par trio),
d'autres ont pensé et écrit le Christ et Marie-Madeleine fort
proches.
Ainsi, fort étrangement, nous nous trouvons face à deux tableaux mettant
en valeur Marie-Madeleine, l'un par omission à Rennes-les-Bains (car la
sainte n'y figure plus), l'autre par volonté évidente du peintre
(Rubens) dont tout le mouvement de l'œuvre conduit à Marie-Madeleine.
Mais, nous ne pouvons pas oublier non plus sur ces deux reproductions,
toutes deux inversées, la présence d'un plat creux contenant le sang du
Christ.
|

|
|
|
Une autre
descente de croix signée Rubens
Voir aussi celle de la cathédrale Saint-Omer
(1)
|
|
|
|
|
|

|
Dans
plusieurs pages, nous avons considéré que le
Graal, décrit dans les textes médiévaux sous la forme
d'un plat creux, tout à fait similaire à celui que nous montrent ces
deux peintres d'Anvers pouvait n'être qu'une allégorie. Allégorie
souvent signalée à l'attention de l'observateur par une inversion, un
anachronisme, la reprise d'un légendaire porteur d'un sens caché et
selon cette approche, ce tableau de Notre-Dame de Marceille aurait
sûrement encore beaucoup à nous apprendre qu'il serait trop long de
développer ici.
|
|
|
|
|
|
Il est bien troublant de
constater, une fois encore, ces clins d'œil lancés à qui les verra et
surtout y croira. Car combien d'esprits trop cartésiens continueront à
prétendre que tout cela n'est que vue de l'esprit et qu'il est normal
pour des peintres locaux inspirés par de vagues gravures de commettre
certaines "erreurs".
Aussi me permettrais-je de vous inviter à un petit voyage en un lieu bien
énigmatique lui aussi et pour lequel le 17 janvier a une valeur toute
particulière.
C'est dans la petite chapelle des Arcs (2) sur Argens que repose
(encore que le terme soit bien relatif car son corps a tellement été
"manipulé" (3) Sainte Roseline (1263-1329) fille de Giraud II
de Villeneuve, seigneur des Arcs, religieuse au monastère
de la Celle-Roubaud (4). Roseline que l'ambigu Plantard mentionnera
deux fois dans sa préface au livre d'Henri Boudet :
"Dans l’église
de Rennes-le-Château, sainte Germaine de Pibrac remplace sainte Roseline."
Voir le livre de Hubert Larcher, Le sang
peut-il vaincre la mort. p 460.
Un étrange
ouvrage aussi que celui d'Hubert Larcher qui s'interroge sur le miracle
alchimique du sang de Saint... Janvier (bien sûr) !
Mais ce qu'il y a de bien plus étonnant encore, est bien que les prêtres
en charge de cette chapelle consacrée à la sainte provençale aient
choisi d'en décorer un mur par une copie d'un certain tableau de Pierre
Paul Rubens ...que voici :
|
|
|
|
|

|
|
|
"Descente
de Croix" de la Chapelle Ste Roseline des Arcs
|
|
|
|
|
Christian Attard
|
|
|
|
|
Notes et sources
(1)
voir sur ce site l'histoire de la restauration du corps de la sainte :
http://www.transenprovence.org/article-23177294.html
(2) On se
souvient de l'Arcis présent sur la dalle de Blanchefort. C'est aussi
rue des Arcis que séjourna longtemps la pierre tombale de Nicolas
Flamel.
(3) Une descente de croix attribuée à Rubens dans le Cathédrale de
Saint-Omer http://www.cathedrale-saint-omer.org/?/mobilier/Tableaux
(4) On se
souvient du Cèllis de la même dalle. |
|
|
|
|
Retour
vers la Reine
|
|