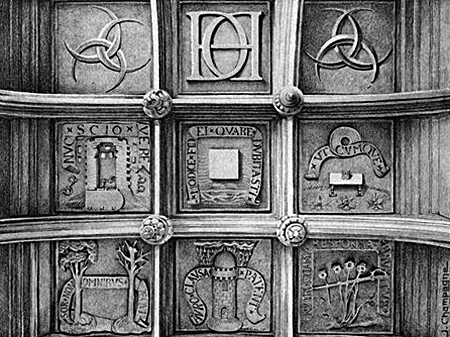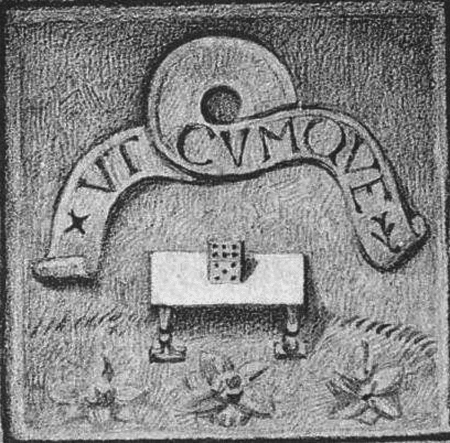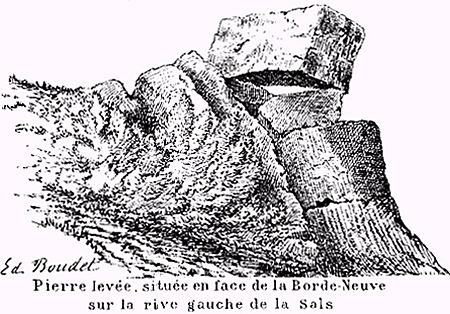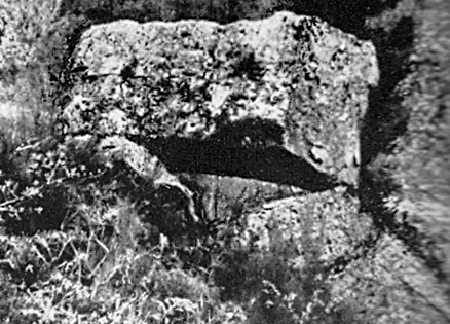|

|
Dans
le fantastique lexique de Rennes-le-Château, ce mot de "Dé" évoque, pour
les connaisseurs de l'histoire, un lieu tout à fait particulier que
décrit Henri Boudet de la manière suivante dans "La
vraie langue celtique et
le Cromleck de
Rennes-les-Bains" :
" On pourrait s'étonner à bon droit de ne rencontrer aucun dolmen
parmi ces monuments celtiques. Nous en avons retrouvé sept ; cinq
sur les flancs du Serbaïrou, et deux aux Roukats.
Le plus remarquable est
situé en face de la Borde-neuve, tout près d'une grande pierre carrée,
étrangement posée en équilibre sur une roche. Ce dolmen, fermé à une
extrémité, offre l'image d'une grotte. En se plaçant sur le chemin
conduisant à Sougraignes, l'œil distingue aisément la structure de
toutes ses parties. Tout à fait dans le haut, directement au-dessus du
dolmen, une roche de la crête porte une croix grecque gravée dans la
pierre : c'est la plus grande de toutes celles qu’il nous a été
donné de reconnaître.
En se rapprochant de l'ancien chemin de Bugarach,
à la même hauteur que celle du dolmen, une roche énorme est ornée
d'une pierre assez forte présentant la forme ronde du pain."
Cet exposé étant coupé par deux illustrations, les seules du livre,
l'une d'elles reproduit très fidèlement, non pas le dolmen évoqué, mais
la grande pierre carrée (donc cubique, bien qu'elle ne le soit pas en
réalité).
Mais Henri Boudet ne la nomme pas "Pierre du Dé", et il faudra pour cela se
référer à l'incontournable Gérard de Sède dans "L'or de Rennes"
(1) où, remarquant le tableau peint par Saunière
sous l'autel, il relève la phrase aujourd'hui effacée :
JESU.MEDELA+SPES.UNA.POENITENTIUM PER.MAGADALENAE.LACRYMAS+PECCATA.NOSTRA.DILUAS.
Et notant, à juste titre, les accents et point sur le i qui ne devraient pas y
figurer, il croit pouvoir mettre ainsi en exergue : "Jé dè né ni". Il en fait
Jais (il existe une mine de jais), dè (une pierre près du Serbaïrou), nez
(un rocher près de Peyrolles) et nid (le Cardou). Quelques pages avant,
il rappelait que dans la toponymie de la région le mot lys (du latin
lesia) désigne une pierre levée !
Et
joignant à ses écrits lui aussi, une image, il nous montre cette même
pierre (photo ci-contre) en demandant semble-t-il au retoucheur de
service d'en
assurer le contour par quelques traits de gouache noire.
Étrange insistance de de Sède a nous montrer ce dé !
Et si cette pierre est donc bien présente de manière iconographique, ce
n'est pas le cas du dolmen qui l'accompagne et de la pierre en forme de
pain. Ce n'est pourtant pas, là encore pour cette dernière, faute de
l'avoir suggérée à plusieurs reprises par divers procédés et dans la
"vraie langue celtique" et dans "L'or de Rennes".
Tout porte donc à regarder d'un peu plus près cet ensemble de pierre
disposé aussi étrangement.
A le regarder de plus près, aussi bien sur le
plan physique que symbolique...
|
|
Il existe
sur les
plafonds du château de Dampierre-sur-Boutonne en Charente-Maritime une représentation
qui n'est pas sans évoquer à la fois la table de pierre et le dé !
On doit à Julien Champagne, disciple de "Fulcanelli" la retranscription des caissons de plafond de ce château que l'on voit
ci-dessous.
Le
symbole des trois croissants de lune entremêlés n'est pas inconnu des
observateurs attentifs et promeneurs de Rennes-Le-Château, comme on
peut en juger par la photo ci-contre, prise dans le village.
Il est incontestablement pour Fulcanelli la marque du secret alchimique
:
"../.. nous avons fait cette constatation, assez surprenante,
que la plupart des hôtels ou châteaux porteurs du double D lié à la
lettre H et du triple croissant, ont une décoration de caractère
alchimique incontestable."
|

|
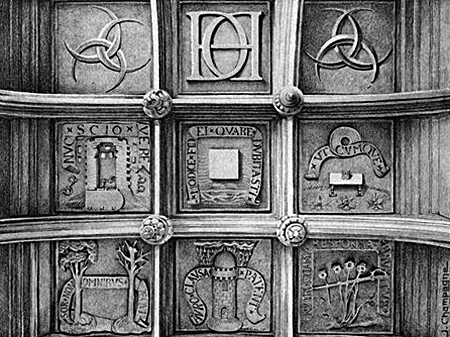
|
On
observe d'autre part que la seconde ligne de caissons présente sous
diverses formes la pierre philosophale : dans sa prison de
"Pierre", sur les eaux mercurielles et sous la forme d'un dé
à jouer sur une table !
Voici le commentaire de Fulcanelli :
"Un dé à jouer est posé sur une petite table de jardin; au
premier plan végètent trois plantes herbacées. Pour toute enseigne,
ce bas-relief porte l'adverbe latin: .VTCUMQVE. En quelque manière,
c'est-à-dire d'une façon analogue."
Le
dé à jouer a donc une autre signification ésotérique. Sa figure, qui
est celle du cube (du grec : dé à jouer, cube), désigne
la pierre cubique ou taillée,
notre pierre philosophale et la pierre angulaire de l’Église. Mais,
pour être régulièrement dressée, cette pierre demande trois
répétitions successives d’une même série de sept opérations, ce
qui porte leur total à vingt et une. Ce nombre correspond exactement à
la somme des points marqués sur les six faces du dé, puisque en
additionnant les six premiers nombres on obtient 21. Et les trois
séries de sept se retrouveront encore en totalisant les mêmes nombres
de points à Boustrophédon.
1 2 3
6 5 4
|
|
Placés
à l’intersection des côtés d’un hexagone inscrit, ces chiffres
traduiront le mouvement circulaire propre à l’interprétation d’une
autre figure, emblématique du Grand-Œuvre, celle du serpent Ouroboros,
aut serpens qui caudam devoravit.
En tout cas, cette particularité
arithmétique, en concordance parfaite avec le travail, consacre l’attribution
du cube ou du dé à l’expression symbolique de notre quintessence
minérale. C’est la table isiaque réalisée par le trône cubique de
la grande déesse.
Il
suffit donc, analogiquement, de jeter trois fois le dé sur la table, -
ce qui équivaut, dans la pratique, à dissoudre trois fois la pierre,
- pour l’obtenir avec toutes ses qualités. Ce sont ces trois phases
végétatives que l’artiste a représentées ici par trois végétaux."
Les dés à jouer sont donc bien présents dans la symbolique alchimique
mais cela ne signifie pas pour autant qu'il faille rejeter la recherche
sur le terrain.
Loin de là, car rien n'empêche d'imaginer un lien
étroit avec un lieu très particulier, ancrage d'une valeur
tout aussi forte symboliquement.
Christian Attard
|
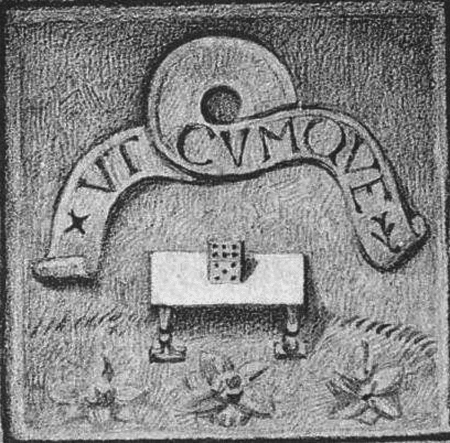
|