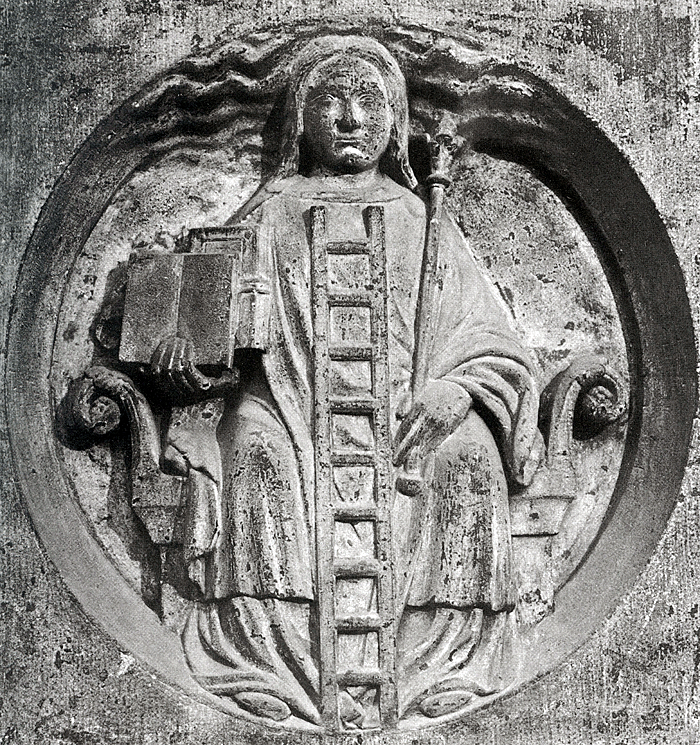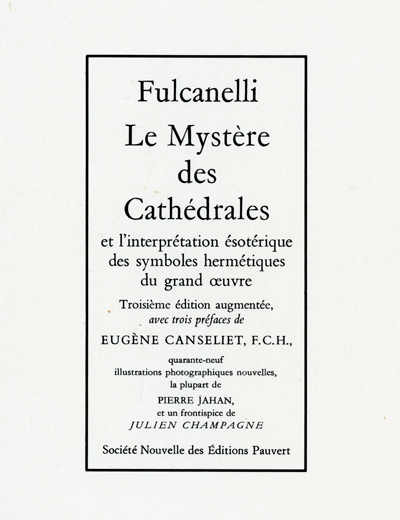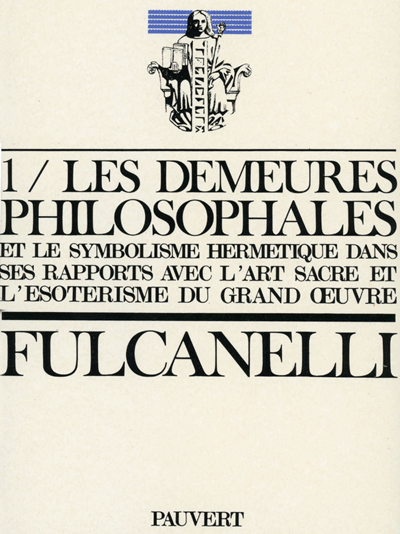|
Demandez
l'auteur !
|
|
|
|
|
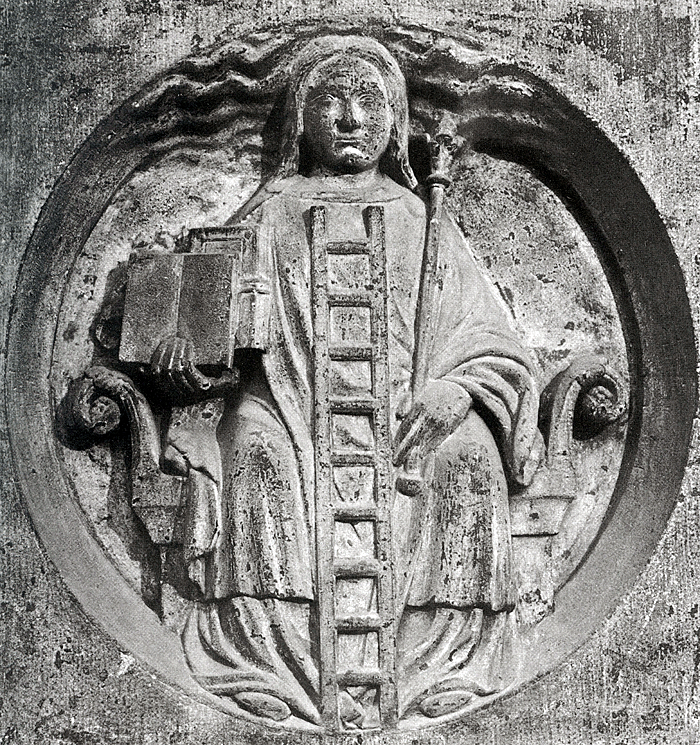
|
|
|
L'Alchimie
selon Fulcanelli. Détail d'un sculpture de Notre-Dame de Paris.
|
|
|
|
|
|
|
On
a tellement écrit et on écrit tellement toujours sur le mystérieux
Fulcanelli que les hypothèses pour percer l'identité de l'auteur du
"Mystère des cathédrales" ou des "Demeures philosophales" surabondent.
On convient ordinairement de croire que ce Fulcanelli a été l'auteur de
ces deux ouvrages, il n'en est rien selon moi. Ou plutôt, pour être plus
clair, le nom générique commun de Fulcanelli couvre en effet
l'écriture de ces deux livres mais l'auteur du texte, selon moi, n'est pas le même.
On doit alors essayer de distinguer qui a rédigé "Les demeures
philosophales" et qui a écrit "Le mystère des cathédrales".
Le mystère des cathédrales (1)
En 1987, André Vandenbroeck publia chez Lindisfarme Press : "Al-Kemi, A memoir", un
ouvrage non encore traduit sur l'hermétiste René Schwaller de Lubicz. M.
Vanderbroeck connut bien Schwaller de Lubicz (1887-1961) pour l'avoir
longuement fréquenté. Voici ce qu'il retranscrit pages 152-153 :
« il faut se souvenir que quand
je dis Fulcanelli, j’entends aussi par là tout un groupe de
littérateurs et de souffleurs : Canseliet, Dujols, Champagne, Boucher,
Sauvage. Tous il donnèrent forme à l’œuvre de Fulcanelli. »
|
|
| d |
|
|
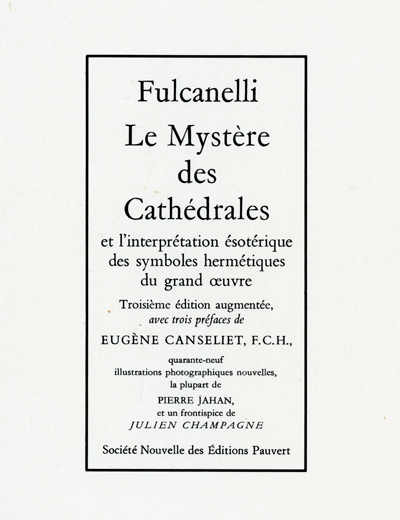
|
Dans « La quête alchimique
de René Schwaller de Lubicz » présenté par Emmanuel Dufour-Kowalski
chez Arché en 2006, voici ce que l'auteur écrit pages 43-44 :
« René Schwaller jette sur le
papier vers 1915 quelques notes concernant les phases symboliques dans
le processus du Grand œuvre qu’il voit alors signifié par les disques
du portail Ouest de la Cathédrale Notre-Dame de Paris ; portail qui
s’ouvre à tous les regards (à la différence du portail Sud). Ce
premier jet dans le déchiffrement hermétique de la cathédrale, qui
créera une nouvelle émulation pour les recherches alchimiques en
laboratoires, est communiqué par hasard à la Closerie des Lilas, à
Julien Champagne.
Le manuscrit complété par ce
dernier, va prendre la forme d’un livre : « Le mystère des Cathédrales
» publié en 1926 chez Schemit, au grand étonnement de l’auteur qui
avouera quelques années plus tard que, pour le coup, « Champagne l’aura
eu pour ses idées ».
Voilà qui semble clair !
Enfin, René Schwaller de
lubicz ayant grandi à Strasbourg, n'était-il pas légitime que la
première cathédrale évoquée dans « Le mystère des Cathédrales » soit justement celle
de Strasbourg, et ce, à propos de la fête de l’âne ?
|
|
|
|
|
|
|
Pour
"Les demeures Philosophales" (2)
|
|
|
|
|
|
|
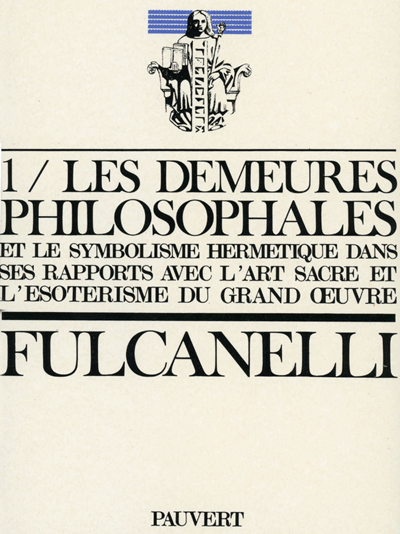
|
Dans son "Hypotypose au Mutus liber" de
Pierre Dujols (1862-1926), la première phrase dit :
« ce titre bien qu’il y paraisse n’a pas
la moindre prétention. Il est tout à fait convenable et génuine au
sujet »
Le mot
"génuine" est un latinisme de genuinus au sens de véritable, exacte.
C’est un terme extrêmement peu usité, à tel point qu’aujourd’hui, il ne
figure même plus dans notre dictionnaire.
Même en
1926-30, on ne trouvait pas ce mot dans les publications françaises.
Or, on trouve page 244 des « Demeures
philosophales » :
« Avec leur texte confus émaillé
d’expressions cabalistiques, les livres restent la cause efficiente et
génuine de la méprise grossière que nous signalons »
Et encore
page 267 :
« C’est que l’alchimie dans son patient
travail doit être le scrupuleux imitateur de la nature, le singe de la
création, suivant l’expression génuine de plusieurs maîtres. »
Ce mot par
l'extrême rareté de son utilisation est une véritable signature qui
authentifie Pierre Dujols comme le véritable auteur des "Demeures
philosophales".
|
|
|
|
|
|
|
Mais, Pierre Dujols avait d’autres expressions très personnelles comme
: « De ce chef ».
A nouveau dans "L’hypotypose" :
« Il s’est formé autour du
mutus liber une légende absurde. Une école qui n’a d’hermétique que le
nom a fait à cet ouvrage un réputation d’obscurité impénétrable et, de
ce chef, le vénère…
Dans "Les demeures" :
« De sorte qu’une langue
quelconque reste toujours susceptible de le véhiculer, de l’incorporer
et, conséquemment de devenir cabalistique par la double acceptation
qu’elle prend de ce chef ».
Une autre de ses allégories favorites était le fameux
manteau du philosophe.
Dans "L’hypotypose" :
En épinglant ces quelques pages de commentaires aux planches
allégoriques du Mutus liber, nous nous sommes proposés sans quitter le
manteau du philosophe, d’en faciliter la lecture… »
Dans "Les demeures" :
« Nous savons ce qu’il en coûte pour troquer les diplômes, les sceaux
et les parchemins contre « l’humble manteau du philosophe ».
« On peut voir au portail occidental de la cathédrale de Chartres, une
très belle statue du XIIè siècle… C’est un grand vieillard…drapé dans
l’ample manteau du philosophe. ./.. …quatre d’entre elles portent le
manteau du philosophe. »
Cette allégorie du manteau est souvent utilisée par Dujols
dans ses notices : « La
Franc-maçonnerie enveloppée dans le manteau des emblèmes ». par
exemple.
Enfin M. Coton-Alvart écrit à ce propos : « Je ne
comprends pas la publication des livres de Fulcanelli, en effet mon ami
Pierre Dujols m’avait fait lire ses manuscrits et les a passés à
quelqu’un d’autre qui les a publiés sous le nom de Fulcanelli… »
MM. Coton-Alvart et Scwhaller de Lubicz avaient tous les deux raison et
je ne peux à aucun moment les suspecter de mensonges car ils furent
bien plus brillants et savants que ne le furent jamais Canseliet ou
Champagne. L’un évoquait les Demeures philosophales et l’autre le
Mystère des cathédrales.
Je préfère ne pas savoir dans quelle condition M. Champagne publia
réellement ses deux textes…
Christian Attard
|
|
|
|
|
| Sources :
(1) Le Mystère des Cathédrales et l’interprétation ésotérique des
symboles hermétiques du Grand-Œuvre. Préface de E. Canseliet, F. C.
H. Ouvrage illustré de 36 planches d'après les dessins de Julien
Champagne, Paris, Jean Schemit, 1926, in-8, 150 p. Dernière
réédition : Société nouvelle des Éditions Pauvert, Paris, 2002,
250 p.
(2)
Les Demeures philosophales et le Symbolisme hermétique dans ses
rapports avec l'art sacré et l'ésotérisme du grand-œuvre.
Préface de Eugène Canseliet, F. C. H. Ouvrage illustré de 40 planches,
d'après les dessins de Julien Champagne Paris, Jean Schemit, libr.,
1930. In-8, 351 p.. Dernière réédition : Société nouvelle des
Éditions Pauvert, Paris, 2001, 2 volumes (470 et 390 p.).
|
|
|
|
| Retour vers la Reine |
|
|