|
Les chiens de garde de la République |
PP |
|
| |
|
|
|
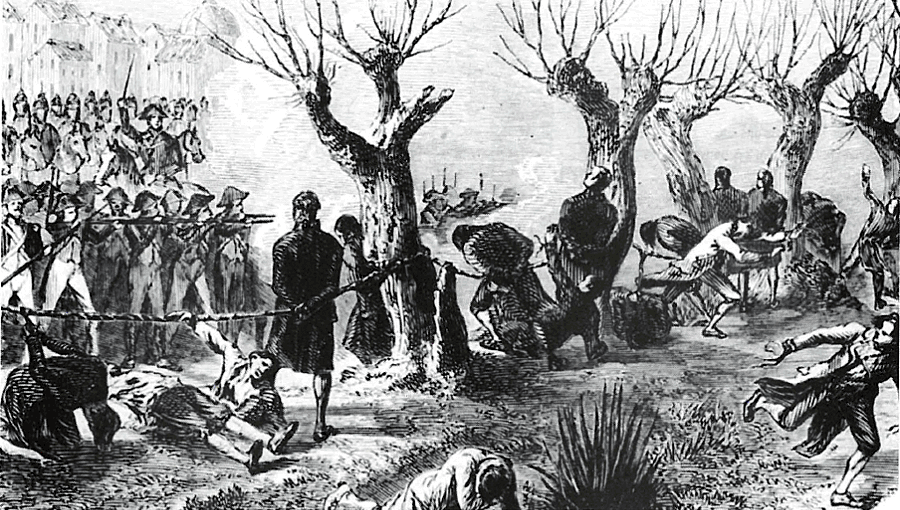 |
||
| Décembre 1793, Fouché fait fusiller les
jeunes lyonnais. |
||
| |
||
| |
||
|
Contre toute révolte
ou insurrection, une ferme opposition du pouvoir
menacé s’est toujours « manifestée ». Aussi paradoxal
que cela puisse l’être, en France, nos institutions de
nature démocratique, bâties sur la Déclaration des
droits de l’homme de 1789, ont parfois usé des pires
violences qui soient pour se maintenir en place.
Ainsi trois hommes parmi bien d’autres se sont particulièrement distingués par leur férocité dans cette répression. |
||

|
||
| Joseph Fouché, duc d'Otrante (1759-1820) | ||
| Le mitrailleur de Lyon | ||
| Le cas de Joseph Fouché est
édifiant à plus d’un titre. Né à Nantes le 21 mai 1759,
il fait toute son éducation chez les oratoriens.
Aujourd’hui, le grand public ayant connaissance de son
nom et de ses actions a toujours tendance à considérer
que, comparé à Talleyrand son contemporain, l’homme est
mal dégrossi, vulgaire. Il n’en est rien. D’abord, parce que sa formation religieuse est solide puisqu’il reçoit les ordres mineurs des pères de l’Oratoire qui n’ont jamais eu la réputation d’être très laxistes ; ensuite, parce que sa formation scientifique l’autorise à devenir enseignant. Lorsque éclate la Révolution, Fouché en est tout de suite l’un des députés les plus actifs, il vient d’avoir trente ans. Girondin puis montagnard, ses prises de positions se durcissent. Il fait partie du comité de l'instruction publique et le prêtre écrit : « Toute religion avilit l’homme et le dégrade ». Il vote la mort du Roi. Été 1893, Lyon vient de se soulever contre les révolutionnaires. La ville qui fut si prospère est en plein marasme économique. Chalier, président du District, remet en cause toute avancée libérale et fait exécuter plus de neuf cents Lyonnais avant de jeter leurs corps dans le Rhône. Il est finalement guillotiné à son tour par les contre-révolutionnaires. Fouché vient lui d’avoir une fille qu’il prénomme « Nièvre » et s’exclame du haut de la chaire de l’église de Nevers où il vient d’être envoyé : « Il est temps que cette caste orgueilleuse, ramenée à la pureté des principes de la primitive église, rentre dans la classe des citoyens… » Et de pousser les prêtres au mariage et à l’adoption ! L’ancien oratorien est déchaîné, il pille églises et couvents, va même jusqu’à faire ouvrir le tombeau de Vauban dans l’espoir d’y trouver de l’or et disperse au vent les cendres du grand architecte, décapite les statues, brûle les habits sacerdotaux, « ces déguisements de la superstition ». Il édicte son fameux arrêt contre toute pratique religieuse ostentatoire, et change, non sans humour, le nom de toutes les rues de Nevers : la rue des Docteurs devient ainsi la rue de l’Ânerie, la rue des Sept-Prêtres la rue des Dupes, etc. ; il met surtout à sac la région et envoie sur Paris dix-sept malles pleines d’or, d’argent et de pierreries. Enfin, il fait abattre les deux clochers de la ville sous le seul prétexte que l’égalité ne les autorisait pas à dépasser le reste des habitations. À Lyon, le mouvement de sympathie royaliste prend la tête de la région, obligeant les armées révolutionnaires conduites par Kellerman à un véritable siège. Début octobre, la ville finit par se rendre : commence alors la plus impitoyable des répressions. Lyon est débaptisée et se nommera désormais « Ville-Affranchie ». C’est dans ce contexte que Fouché est désigné le 30 octobre 1893 avec Collot d’Herbois, un mauvais comédien ambulant, à « s’occuper » de Lyon. « Oui, nous osons l’avouer, nous faisons répandre beaucoup de sang impur, mais c’est par humanité et par devoir. » Joseph Fouché Dès leur arrivée, les deux hommes accompagnés d’une cohorte de massacreurs pillent la ville et décapitent les statues à coups de hache. On récupère la tête de Chalier qui devient objet sacré et Fouché organise une cérémonie anti-cléricale au cours de laquelle il affuble un âne des habits sacerdotaux, lui fixant une mitre sur la tête. Mais après cette ludique entrée en matière débute la sanglante répression. On arrête à tour de bras, les prisons sont pleines. Fouché s’impatiente, tout cela va trop lentement. Il réclame le canon, le feu pour épurer l‘ancienne Lyon. La guillotine ne s’arrête plus. Le Rhône charrie des cadavres par centaines. Fouché et Collot d’Herbois vont imaginer pire encore. Ils font placer, garrottées par deux, plus de soixante-quatre personnes face à la bouche de leurs canons sur la place des Terreaux ; les blessés sont achevés à coups de sabre. Les boulets se révélant peu efficaces, on charge les jours suivants les canons à mitraille. C’est une immonde boucherie élevée au culte de la Raison ! Loin d’être désavoué pour ces crimes odieux, la Convention félicite Fouché. Mais le vent commence à tourner, les plus sanguinaires tyrans vont passer à leur tour sous le couperet. Il est temps pour Fouché de retourner sa veste et de rejoindre Paris. Il laissera derrière lui, une ville exsangue et des milliers de morts. Les historiens tentent de s’accorder sur un chiffre avoisinant les mille six cent victimes du seul fait de Fouché, mais encore faut-il compter tous ceux qui périrent en prison. |
||
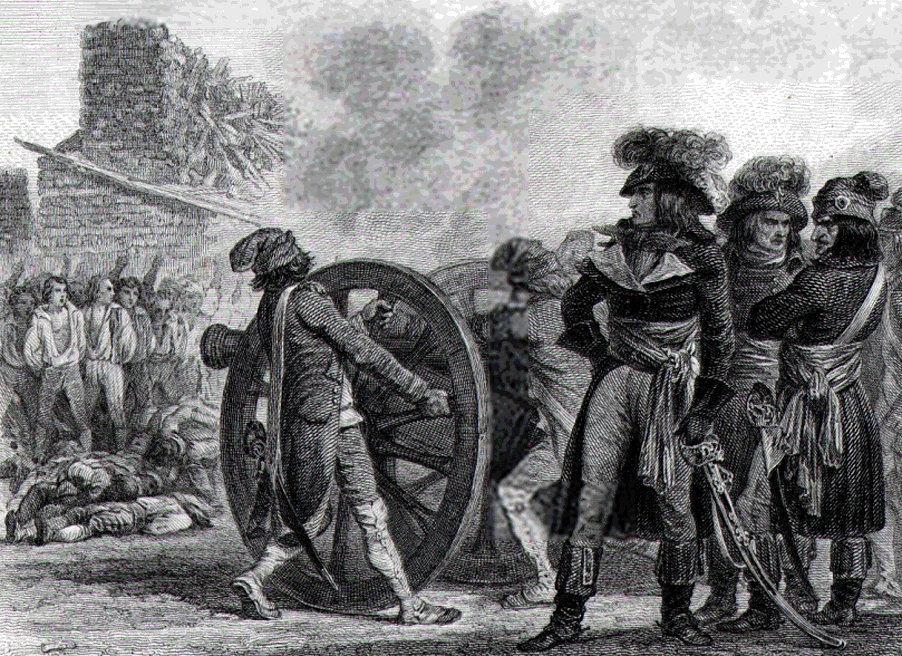 |
||
| Le massacre de la place des Terreaux à
Lyon. |
||
| L’homme aurait dû être jugé pour ses
crimes, il n’en fut rien. Napoléon lui laissera le
ministère de sa Police où ses expériences de
manipulateur et de traître à toute cause lui rendront
d’immenses services. Il est fait comte d’Empire, duc
d’Otrante. À la chute de Napoléon, Louis XVIII le nomme
même ministre. Laissons Chateaubriand dans ses «
Mémoires d'outre-tombe » nous décrire l’événement : « Ensuite, je me rendis chez Sa Majesté : introduit dans une des chambres qui précédaient celle du roi, je ne trouvai personne ; je m'assis dans un coin et j'attendis. Tout à coup une porte s'ouvre : entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime, M. de Talleyrand marchant soutenu par M. Fouché ; la vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît. Fouché venait jurer foi et hommage à son seigneur ; le féal régicide, à genoux, mit les mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr ; l'évêque apostat fut caution du serment. » Fouché s’éteignit en 1820 en exil pour seule cause de régicide, paré de tous ses titres et grand aigle de la Légion d’honneur. |
||
|
|
||
 |
||
| Louis-Eugène Cavaignac (1802-1857), huile
sur toile par Jean-Baptiste Delafosse (Source Wikipédia) |
||
| Le massacreur de
48 |
||
|
Louis Eugène
Cavaignac, est né le 15 octobre 1802 à Paris. Son
père, à la Restauration, dut s’exiler parce qu‘il
était considéré comme régicide. Louis fit une
carrière militaire exemplaire, Polytechnique,
École d’artillerie de Metz, Génie. Lors de la
révolution de 1830, il est mis en non-activité
pour cause de « sympathies républicaines ». Puis
on le pousse à aller chatouiller la barbe d'Abd
el-Kader en Algérie. Là, il se couvrira de gloire,
résistant à tous les assauts kabyles et y gagnant
ses galons de commandant. On sut lui être
reconnaissant de porter en terre algérienne, à
coups de fusil et de sabre, les belles valeurs
républicaines de notre démocratie.
C’est lui qui imagine bien avant les grottes d’Ouvéa, et se souvenant sans doute des massacres cathares, d’acculer ses ennemis dans des cavités qu’il enfume avec soin. Le brave général Bugeaud conseillera de suivre l’exemple de Cavaignac : « Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavaignac aux Sbéhas ! Enfumez-les à outrance comme des renards. » Des milliers de ces « gredins », femmes, vieillards et enfants, périront ainsi asphyxiés. Ces hauts faits d’armes vaudront à l’inventif Cavaignac le titre de commandeur de la Légion d’honneur, de maréchal, de général, mais l’homme n’avait pas encore donné toute sa mesure… Il lui fallut pour cela une autre révolte, celle de juin 1848. |
||
 |
||
| Le peuple de Paris
excédé de misère bouscule la monarchie
constitutionnelle de Louis-Philippe, qui se résout
trop tardivement à congédier son impopulaire
ministre et chef du gouvernement Guizot. La
République est proclamée le 25 février 1848. En
juin, rien ne va plus et le nouveau gouvernement
vacille sous la poussée des partisans d’une
République démocratique et sociale. Cavaignac est entre-temps devenu ministre de la Guerre et il a soin de mater l’insurrection. En trois petites journées, les historiens estiment que mille six cents personnes furent tuées pour défendre le gouvernement, alors que plus de cinq mille autres le furent dans l’espoir d’une République plus juste et moins aveugle aux malheurs du peuple. On remercia chaudement Cavaignac pour sa redoutable efficacité, il fut cette fois nommé maréchal mais l’homme avait d’autres ambitions, celles d’être porté aux plus hauts sommets du pouvoir exécutif. Il n’y parviendra pas et se contentera de la fonction de député de Paris. Il s’éteindra en 1857. |
||
|
|
||
 |
||
| Le général
Galliffet |
||
| Le marquis aux talons rouges | ||
| Gaston Alexandre Auguste de
Galliffet, marquis de Galliffet, prince de
Martigues, est né à Paris le 23 janvier 1831. Après
des études somme toute assez médiocres, il s’engage
dans l’armée à dix-sept ans. Cinq ans plus tard, il
est sous-lieutenant d’un régiment de chasseurs à
cheval et arbore fièrement sa légion d’honneur. Un
héritage conséquent aurait pu dispenser ce flambeur
de toute prise de risque militaire mais bien au
contraire, l’homme est un va-t-en guerre qui veut
monter au front de tous les combats qui s’offrent à
lui. Crimée, Algérie, Mexique : partout il se
précipite sus à l’ennemi, sabre au clair. Napoléon
III et la belle impératrice Eugénie raffolent de ce
bravache qui le 19 avril 1863 sera grièvement blessé
au ventre lors du siège de Puebla au Mexique. Il fut
obligé de « porter ses tripes dans son képi », comme
il s’en vantera plus tard, et vivra désormais avec
une plaque d’argent sur le ventre. La moustache arrogante et fournie, le crane rasé, il présente avec morgue une de ses tronches d’uhlan qui faisaient se pâmer les dames de la bonne société parisienne. Il est général à Sedan en 1870 et charge toujours à la tête de sa brigade quand d’autres restent confortablement planqués dans Paris. Face aux Prussiens, il doit capituler lui aussi. L’empereur est fait prisonnier avec quatre-vingts mille hommes, Galliffet est du lot. Le second Empire tombe, Bismarck triomphe… La Commune, soixante-treize jours de lutte fratricide. Les insurgés de Paris refusent la honte d’une paix prussienne. Pour eux qui ont tenu face à l’ennemi, c’est un lâchage des politiques nouvellement élus, Thiers en tête et ses généraux inconsistants. Les classes populaires, sensibles aux idées de Proudhon, Blanqui, Marx, tiennent tête aux militaires de Versailles, les retournent, chantent la République universelle. Paris est assiégée au nord par les Prussiens, au sud par les Versaillais. C’est à ce moment que Galliffet, à qui l’on a confié le soin de reprendre les choses en main, fait fusiller tous les prisonniers communards : il n’arrêtera plus jusqu’à la mort même du mouvement insurrectionnel. Son seul choix prévaut, il décide selon ses humeurs qui doit être abattu sommairement. On le surnomme déjà le « Marquis aux talons rouges », il n’en a cure et assume sa férocité. Femmes, enfants, vieillards, il n’épargnera personne. On estime à quelques trois mille morts le nombre de ses victimes, abattues sans autre jugement que le sien. Ce soldat impitoyable s’est fait assassin sans le moindre scrupule et la République élue, triomphante, ne cessera dès lors de le couvrir d’honneur et de gloire, grande croix de la Légion d’honneur, ministre de la Guerre. On rapporte que conspué par des députés socialistes sous les cris : « Assassin ! », il répondit : « Assassin ? Présent. » Le fusilleur de la Commune s’éteindra en 1909. Ces trois hommes, qui ont en commun d’avoir été honorés par la République, ont conduit plusieurs milliers de personnes, de Français tout comme eux, à une mort horrible sans le moindre jugement et sous les nobles mots d’« Égalité, Fraternité et Liberté ». Ils eurent, en leur temps, la raison d’État pour soutien de leurs actions les plus abjectes. Les passions éteintes, la véritable raison revenue, ils auraient dû, pour le moins, être bannis à jamais de toute forme de respect ou de considération. Bien au contraire, la République leur a maintenu leurs titres et privilèges. Ces trois hommes sont sûrement ceux dont on se souvient le plus mais tant d’autres ont agi de même. Sous couvert de légitimité républicaine, ils se réclamèrent tous d’un système qui, aujourd’hui encore, est bien loin d’avoir reconnu et dénoncé tous les crimes qui furent commis en son nom. Christian Attard. |
P |
|
| notes | ||
| A propos de Joseph Fouché, On lira la biographie enlevée de Stéfan Zweig qui privilégie l’approche psychologique du personnage, tout en s’appuyant sur une autre biographie de Louis Madelin. Construites sur des découvertes plus récentes, on trouvera les remarquables biographies d’André Castelot et de Jean Tulard. A propos d’Eugène Cavaignac, On ne trouve rien de très objectif dans la presse où les biographies partielles de son époque. L’ouvrage de Pierre Ibos : « Le Général Cavaignac : Un dictateur républicain. » s’attache surtout à évoquer son action politique. Jean-Jacques Tur évoque ses exactions en Algérie dans son ouvrage « Ombres et lumières de l'Algérie française » A propos de Gaston de Galliffet, Il n’existe pas à ce jour de biographie. On trouvera cependant amplement renseignées ses actions au cours de la Commune dans la Presse d’époque et les nombreuses études sur cette insurrection. |
||
| |
||
| Retour vers la Reine | ||